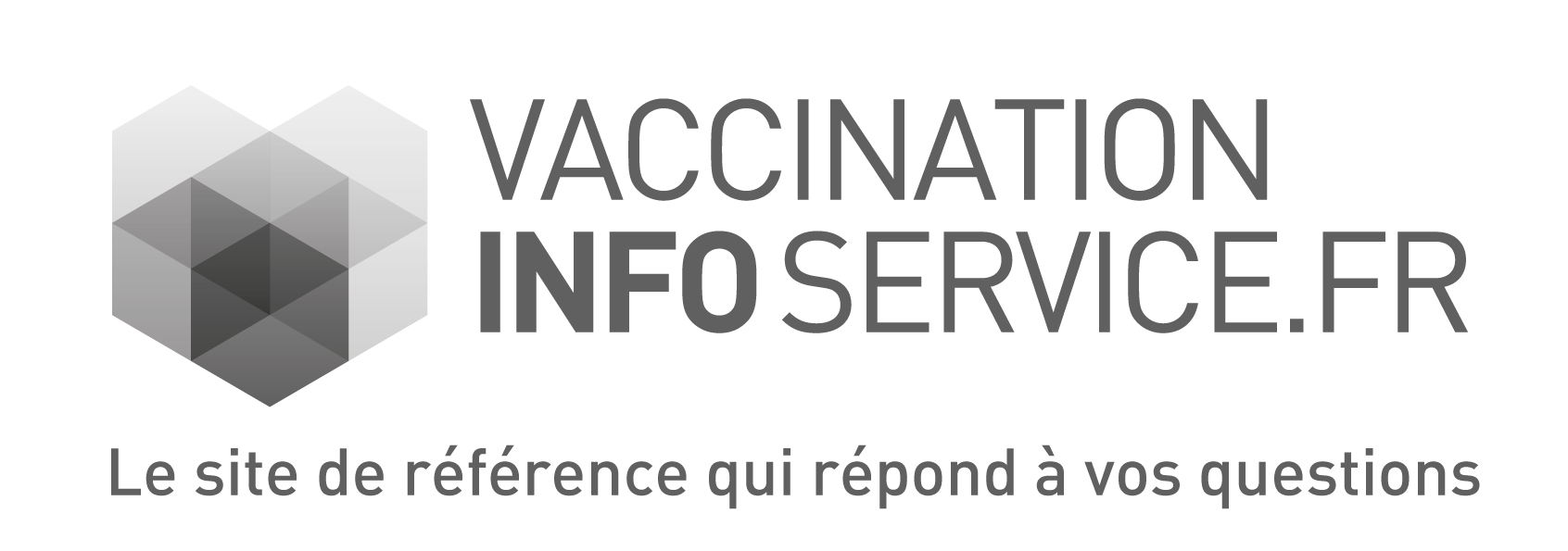Données issues des essais cliniques
Ces données produites par les laboratoires sont revues par des experts scientifiques indépendantes réunis en Europe par l’Agence Européenne du médicament (EMA) et aux USA par la Food and Drug Administration (FDA).
La sécurité de Comirnaty LP.8.1 est extrapolée à partir des données de sécurité relatives aux précédents vaccins Comirnaty.
Vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty® JN1)
Les effets indésirables observés au cours des études cliniques sont présentés ci‑dessous par catégories de fréquence.
Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) est disponible.
La sécurité des vaccins adaptés est similaire à celle du vaccin Comirnaty précédemment autorisé.
Données de terrain
Les données de terrain ne sont pour le moment pas disponibles sur le nouveau vaccin Comirnaty® JN1 mais uniquement sur les formes précédentes des vaccins contre le Covid-19.
Signalement des effets indésirables
L'EMA a indiqué que plus d’un milliard de doses de vaccins avaient été administrées en Europe depuis le début de la pandémie. Les vaccins autorisés sont sûrs et efficaces. La plupart des effets secondaires sont bénins, et les effets graves très rares.
Un suivi spécifique des femmes enceintes ou allaitantes a également été mis en place. Les données des études et de surveillance post-commercialisation avec les vaccins à ARNm (Comirnaty® ou Spikevax®), contre le Covid-19 n’ont pas montré de conséquence néfaste sur le déroulement de la grossesse ou le développement de l’embryon ou du fœtus.
En février 2025, les rapports d’enquête réalisés par l'ANSM confirment à nouveau que les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs.
Actuellement aucun des effets indésirables ne remet en cause le rapport bénéfice risque des vaccins utilisés :
Avec le vaccin Comirnaty®
Suivi des enfants de moins de 5 ans aux Etats-Unis
Le 2 septembre 2022, le CDC a publié un bilan de l’utilisation des vaccins Pfizer et Moderna chez l’enfant qui montre que les réactions locales et systémiques retrouvées étaient attendues, et les effets secondaires graves étaient rares.
Suivi chez les enfants (5-11 ans)
En France, l’ANSM n’a identifié aucun signal sur la période avec le vaccin Comirnaty®.
Suivi chez les jeunes (12-17 ans)
En France, aucun signal spécifique n’a été identifié chez les enfants et les jeunes. Au vu des données analysées, le profil de sécurité du vaccin Comirnaty® chez les enfants et les jeunes est comparable à celui des adultes.
Suivi chez les adultes
En France, plus de 123 millions d’injections ont été réalisées chez les adultes.
Pour le vaccin Comirnaty®, un signal potentiel concernant de très rares cas de neuropathies à petites fibres (douleurs à type de brûlure, principalement au niveau des pieds et des membres inférieurs) a été identifié en février 2025. Ils font l’objet d’investigations complémentaires par l’ANSM et les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV). Elles permettront de prendre, le cas échéant, des mesures adaptées à la nature et au niveau du risque, en lien avec l’Agence européenne des médicaments (EMA).
Suivi spécifique des effets indésirables rapportés après une dose de rappel
Dose de rappel chez les 12-17 ans
Au 28 août 2023, aucun signal spécifique n’a été identifié chez les personnes ayant eu une dose de rappel, que ce soit avec le vaccin monovalent ou le vaccin bivalent. Le profil des effets indésirables rapportés est similaire à celui rapporté après la primo vaccination.
Dose de rappel chez les adultes de 18 ans et plus
Au 28 août 2023, aucun signal spécifique n’a été identifié chez les personnes ayant eu une dose de rappel, que ce soit avec le vaccin monovalent ou le vaccin bivalent. Le profil des effets indésirables rapportés est similaire à celui rapporté après la primo vaccination.
Avec les vaccins bivalents, les effets indésirables sont similaires et décrits dans les RCP respectifs du vaccin Comirnaty® Original/ Omicron BA.1, du vaccin Comirnaty® Original/ Omicron BA.4-5.
Le CDC aux Etats-Unis attire l'attention le 13 janvier 2023 sur un signal faible : une augmentation très limitée du taux d'accidents vasculaires cérébraux chez les personnes de 65 ans et plus qui ont reçu le vaccin bivalent de Pfizer. Ce signal n'a pas été retrouvé dans les autres études et dans d'autres pays. A ce stade, les recommandations de vaccination de rappel n'ont pas été modifiées.
Point sur les événements cardiovasculaires graves des vaccins à ARNm (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et embolie pulmonaire) survenus chez les personnes de 18 à 74 ans (janvier-juillet 2021).
D’après l’étude Epi-phare,l’incidence des différents événements cardiovasculaires graves n’était pas augmentée dans les trois semaines suivant la première ou la deuxième dose des vaccins à ARNm (Comirnaty® de Pfizer et Spikevax® de Moderna).
Ces résultats confirment la sécurité des vaccins à base d’ARNm vis-à-vis du risque d’événements cardiovasculaires graves chez les adultes de moins de 75 ans.
EPI‑PHARE a publié le 22 juillet 2022 une étude sur le risque de myocardite après une vaccination par un vaccin à ARNm (Comirnaty ou Spikevax), L’étude montre l’existence d’un risque de myocardite après la première dose de rappel (troisième dose). Le risque est plus faible qu'après la deuxième dose et diminue avec l’allongement du délai entre les doses successives.
Vaccins Covid‑19 et survenue du syndrome de Guillain-Barré
Dans le cadre du dispositif renforcé de surveillance des vaccins contre le Covid-19, le groupement Epi-Phare, qui associe l’ANSM et la Cnam, a réalisé une nouvelle étude de pharmaco-épidémiologie pour mesurer le risque de survenue d’un syndrome de Guillain-Barré associé aux différents vaccins contre le Covid-19. Cette étude a été réalisée à partir des données du Système national des données de santé (SNDS).
Entre le 27 décembre 2020 et le 20 mai 2022, un total de 2 229 personnes de 12 ans et plus vaccinées et non vaccinées ont été hospitalisées pour un syndrome de Guillain-Barré en France.
Ces résultats fournissent de nouveaux arguments en faveur de la sécurité de la vaccination contre le Covid-19 telle que recommandée actuellement en France (doses de rappel par vaccins à ARNm).
Suivi des femmes présentant des saignements gynécologiques après une vaccination avec un vaccin à ARNm.
Des effets signalés sont des saignements anormaux (les métrorragies, ménorragies) et des retards de règles et aménorrhées. Des épisodes de saignement ont également été observés chez des femmes ménopausées ou sous traitement hormonal (contraception, traitement de la ménopause...)
Ces effets sont survenus aussi bien après la première injection, qu’après la deuxième injection.
Il s’agit majoritairement d'événements non graves, de courte durée et spontanément résolutifs.
Le comité européen de pharmacovigilance (PRAC) de l’EMA a conclu que les saignements menstruels abondants peuvent être considérés comme un effet indésirable potentiel des vaccins Comirnaty et Spikevax. Les cas déclarés sont le plus souvent “non graves” et transitoires. Les saignements menstruels abondants seront ajoutés dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP) et les notices de ces deux vaccins.
L’ANSM a demandé le 19 juillet 2022 aux femmes présentant ces troubles graves de les signaler sur le portail des signalements du ministère de la santé, en donnant le plus de renseignements possibles, et a mis en ligne un guide et deux tutoriels d’aide à la déclaration : un pour les patientes et un pour les professionnels de santé.
Epiphare a publié le 24 janvier 2024 les résultats d’une étude cas témoins relative au risque de saignements menstruels abondants ayant nécessité une prise en charge à l’hôpital en 2022 au décours de la vaccination contre le COVID-19. Cette étude fournit de nouveaux arguments en faveur de l’existence d’un risque augmenté de saignements menstruels abondants au décours de la vaccination contre le COVID-19 par vaccin à ARNm. La période des 1-3 mois suivant la primovaccination apparaît comme seule concernée par ce risque.
Conduite à tenir pour les professionnels de santé
Devant tout symptôme de troubles menstruels :
- Si la patiente prend un traitement hormonal : vérifier qu’il n’y a pas eu de mauvaise observance ou des vomissements qui pourraient être à l’origine d’une interruption de la prise du traitement ;
- Si la patiente ne prend pas de traitement hormonal ou s’il n’y pas eu d’interruption de traitement :
- vérifier qu’il ne s’agit pas d’une symptomatologie aiguë ;
- vérifier l’absence de grossesse (retard de règles, saignements itératifs) ;
- garder en tête la possibilité que la patiente développe une maladie gynécologique (syndrome des ovaires polykystiques, hyperprolactinémie…) de manière concomitante à la vaccination.
Si les symptômes persistent dans le mois suivant, il est nécessaire de lancer des investigations pour envisager une telle pathologie sous-jacente.
Suivi chez les femmes enceintes ou allaitantes
L’EMA a mis à jour le 17 février 2022 dans les RCP du vaccin Comirnaty® de Pfizer les informations sur le suivi des femmes enceintes ou allaitantes, qui indiquent qu’il n’y a pas de retentissement de la vaccination sur la grossesse, l’allaitement ou la fertilité des femmes.
Une enquête de pharmacovigilance publiée en février 2023 par l’ANSM confirme l’absence de signal chez les femmes enceintes et allaitantes avec l’ensemble des vaccins contre le Covid-19 disponibles en France.
Le 16 août 2024, une nouvelle étude a été publiée concernant le risque d’anomalies congénitales en cas de vaccination pendant la grossesse. Réalisée à partir des données scandinaves, elle porte sur près de 350 000 enfants conçus entre mars 2020 et février 2022. L’objectif de l’étude était d’évaluer le risque d’anomalies congénitales lié à l’infection ou à la vaccination pendant le premier trimestre de la grossesse pour les vaccins à ARNm (le BNT162b2 de Pfizer-BioNTech et le mRNA1273 de Moderna). Les données sont conformes aux résultats de précédentes études et confirment la sécurité d’utilisation du vaccin contre la Covid-19 pendant la grossesse, afin de prévenir l’infection par le SARS-CoV-2, source de complications de la grossesse.
Aucun élément n’indique que ces événements seraient en lien avec le vaccin. Ces événements ne constituent donc pas un signal de sécurité. Ils continueront d’être surveillés tant au niveau national qu'européen dans le cadre du suivi spécifique des femmes enceintes et allaitantes.
3. La surveillance concrète après mise en œuvre de la vaccination
En France, l’ANSM a mis en place dès le début de la vaccination un double dispositif renforcé pour assurer le suivi et la gestion en temps réel des effets indésirables liés aux vaccins contre le COVID-19.
Elle propose plusieurs documents pour accompagner les professionnels de santé dans leur pratique :
- Un guide pratique d'aide à la déclaration des effets indésirables médicamenteux, en particulier lorsqu'ils sont graves et/ou inattendus (non mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit) ;
- Une affiche à l’attention des professionnels, expliquant comment déclarer un effet indésirable suite à une vaccination contre le COVID-19
- Une affiche à l’attention des patients vaccinés, expliquant comment déclarer un effet indésirable suite à une vaccination contre le COVID-19 :
- Une fiche récapitulant les effets indésirables pouvant survenir après la vaccination par le vaccin Comirnaty® de Pfizer/BioNTech et rappelant la prise en charge des personnes vaccinées lors de la surveillance post-vaccination ;
Un suivi spécifique des femmes enceintes ou allaitantes a également été mis en place.