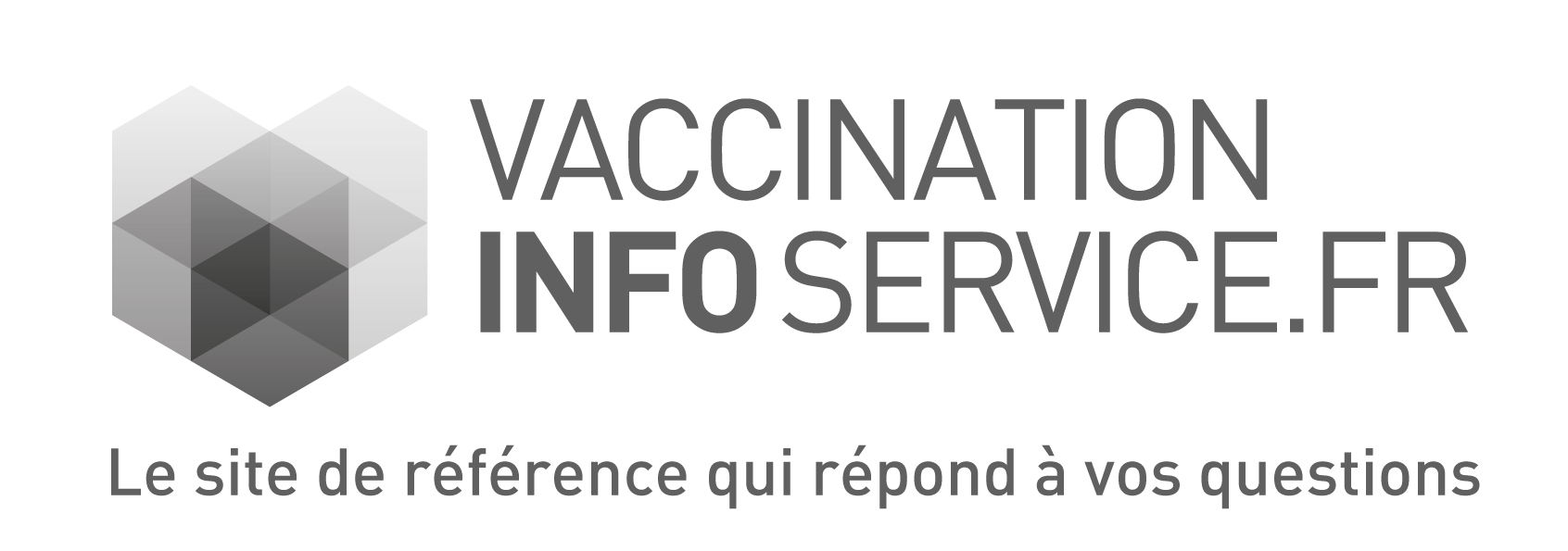Clinique
Symptômes
Cette infection provoque un syndrome de type grippal et peut évoluer vers des complications potentiellement mortelles, appelées dengue sévère. La dengue touche les nourrissons, les enfants en bas âge et les adultes.
La plupart des infections par le virus de la dengue sont asymptomatiques (50 à 90 % des cas). La période d’incubation dure généralement de 4 à 7 jours, mais peut s’étendre de 3 à 14 jours.
Dans la forme symptomatique « classique », le tableau clinique se caractérise le plus souvent par une forte fièvre, accompagnée de céphalées, de vomissements, de douleurs musculaires et articulaires, de douleurs rétro-orbitaires et, de façon inconstante, d'une éruption cutanée vers le 5e jour des symptômes. L’évolution est le plus souvent favorable au bout de quelques jours.
Dans de rares cas (1% des cas symptomatiques), la dengue peut évoluer vers une forme sévère (OMS, 2009). Elle survient 2 à 7 jours après les premiers signes et le retour à la normale de la température (défervescence thermique). La vigilance clinique doit donc être maximale autour du 4e jour d’une dengue. La recherche de signes d’alarme est importante : douleurs abdominales ou sensibilité à l’examen, vomissements persistants, signes d’épanchements liquidiens, saignements muqueux, léthargie ou agitation, hépatomégalie. La dengue grave survient plus fréquemment chez des enfants de moins de 15 ans et chez les personnes ayant déjà été infectées.
Dengue primaire et dengue secondaire
Il existe quatre sérotypes du virus de la dengue. Une infection par un sérotype confère une immunité contre ce sérotype mais pas contre les autres.
On parle de :
-
dengue primaire lors d’une première infection par un virus de la dengue ;
-
dengue secondaire lorsqu’un individu est réinfecté par un autre sérotype. Le risque de développer une forme grave semble plus important lors d'une dengue secondaire que lors d'une dengue primaire.
Traitement
Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique contre la dengue. Le traitement symptomatique recommandé en première intention associe le repos et le paracétamol. L’utilisation d’acide acétylsalicylique (aspirine) et de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (Ibuprofène par exemple) n’est pas recommandée. Les mesures de prévention individuelles ou collectives de lutte antivectorielle sont donc capitales à mettre en place.
Prévention
La prévention individuelle repose essentiellement sur les moyens de protection contre les piqûres de moustiques (répulsifs en sprays ou crèmes, diffuseurs électriques, vêtements longs, moustiquaires). La protection des femmes enceintes et des très jeunes enfants doit être particulièrement renforcée. Le moustique vecteur pique la journée, essentiellement à l’extérieur des maisons, avec une activité plus importante en début de matinée et en fin de journée. La liste des produits répulsifs est disponible dans le numéro spécial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) consacré aux conseils aux voyageurs.
Des documents d’information destinés au grand public sont disponibles sur le site de Santé Publique France.
La lutte communautaire est réalisée notamment par la destruction des gîtes larvaires potentiels autour des habitations (eau stagnante dans les soucoupes, gouttières, vases, seaux, détritus...) pour priver les moustiques des sites où leurs larves peuvent se développer.
La lutte antivectorielle (LAV), à l’échelle des territoires, est réalisée par des opérateurs de démoustication (collectivités territoriales, syndicats de lutte contre les moustiques…).
En métropole, la surveillance est renforcée chaque année, du 1er mai au 30 novembre, pour permettre l’intervention rapide de ces services de LAV autour des cas dans les zones où le moustique Aedes albopictus est présent. En pratique, les médecins et les laboratoires sont sensibilisés au début de la saison au risque de transmission d’arboviroses et au signalement immédiat des cas à l’agence régionale de santé (ARS), qui déclenche une investigation épidémiologique et entomologique.
Epidémiologie
L’incidence mondiale de la dengue a progressé de manière spectaculaire au cours des dernières décennies. Plus d’un tiers de la population mondiale vit dans des zones à risque de dengue.
On estime que, chaque année dans le monde, 500 000 personnes atteintes de dengue sévère, dont une très forte proportion d’enfants, nécessitent une hospitalisation. Environ 2,5 % d’entre elles en meurent.
Le nombre de cas de dengue notifiés à l’OMS a été multiplié par plus de huit au cours des deux dernières décennies, passant de 505 430 cas en 2000 à plus de 2,4 millions de cas en 2010 et 4,2 millions de cas en 2019. Le nombre de décès déclarés entre 2000 et 2015 est passé de 960 à 4032.
Les territoires français d’Amérique sont régulièrement confrontés à des épidémies de dengue, dont une de grande ampleur en 2010 en Martinique et Guadeloupe. La dengue circule également à La Réunion où 3 vagues épidémiques se sont succédées de 2017 à 2020, et à Mayotte où a sévi en 2020 une épidémie importante.
En métropole, un nombre croissant de cas est rapporté depuis 2010 (près de 700 en 2020) et quelques un de ces cas sont autochtones.
Consulter les données en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou dans le monde, sur le site de Santé publique France.