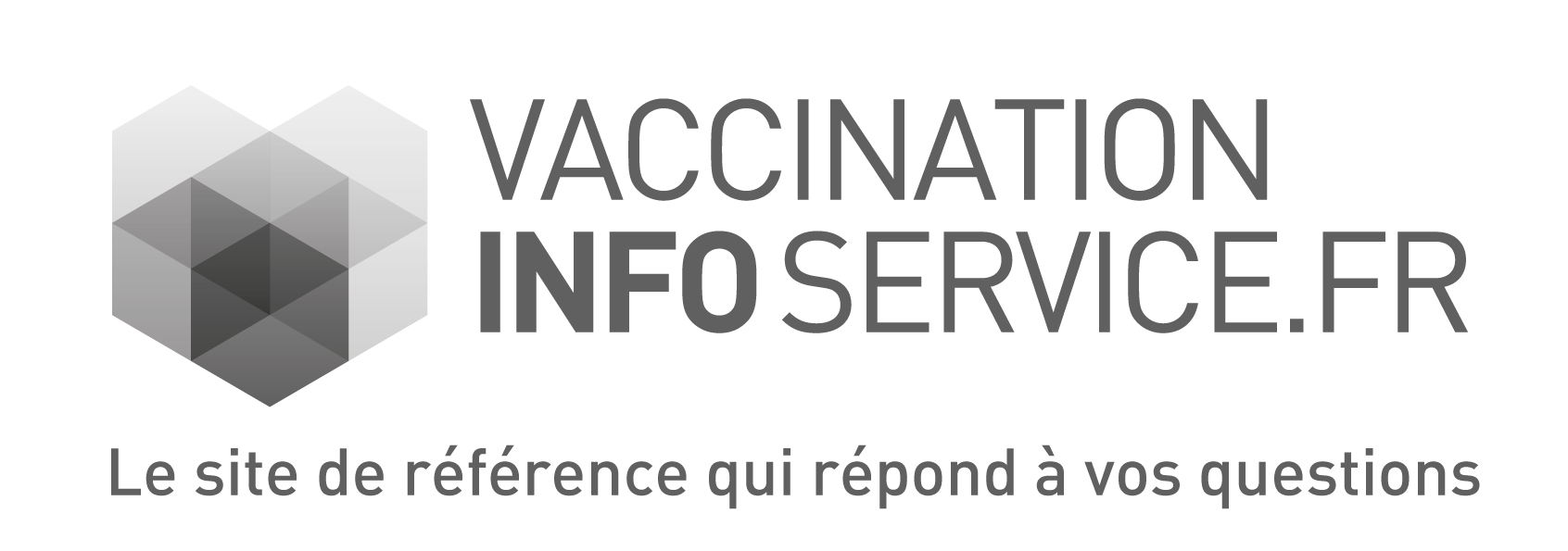Epidémiologie
Le chikungunya est principalement présent dans les pays tropicaux, comme l’Amérique du sud et centrale et la Caraïbe, les îles de l'océan Indien, l'Afrique, l'Inde ou l'Asie du Sud-Est. Des foyers, de 12 et 17 cas, ont aussi été identifiés en France hexagonale (2014 et 2017) et 2 épidémies de quelques centaines de cas sont survenues en Italie en 2007 et 2027. Selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), les risques de transmission de maladies par le moustique Aedes albopictus sont de plus en plus élevés en France métropolitaine.
Sur le territoire français, Aedes aegypti est présent aux Antilles, en Guyane et à Mayotte et Aedes albopictus sur l’île de la Réunion et dans la majorité des départements métropolitains. Les départements-régions d’outre-mer portent l’essentiel du fardeau du CHIK en France. Une épidémie de grande ampleur était survenue à La Réunion en 2005 – 2007, impactant également, dans une moindre mesure, le territoire de Mayotte en 2005 – 2006. Aux Antilles, une épidémie de CHIK était survenue en 2013 – 2015 touchant environ 40 % de la population en Guadeloupe et en Martinique.
La Réunion est actuellement en situation épidémique de CHIK avec une comptabilisation de plus de 2000 cas autochtones de CHIK, depuis le 23 août 2024.
Chaque année des cas importés sont identifiés en France hexagonale, dont le nombre est dépendant de l’épidémiologie mondiale et ,notamment dans les DOM.
C’est une maladie à déclaration obligatoire.
Symptômes
Dans environ 10 à 40 % des cas, le chikungunya est asymptomatique (pourcentage variable selon les épidémies).
Pour les 60% à 90% de personnes présentant des symptômes, l’incubation dure de 3 à 7 jours en moyenne (jusqu’à 1 à 12 jours). Les symptômes sont classiquement :
- Une fièvre élevée d’apparition brutale
- Arthralgies pouvant être intenses, touchant principalement les petites articulations des extrémités (poignets, chevilles, phalanges)
- Myalgies
- Des maux de tête
- Une éruption cutanée maculopapuleuse
L’évolution est le plus souvent favorable au bout d’une dizaine de jours, sans séquelle, mais le chikungunya peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée par des douleurs articulaires persistantes. Celles-ci peuvent survenir chez 30 à 40% des patients et durer plusieurs mois voire années chez quelques patients. L’arthralgie chronique est le symptôme le plus fréquemment rapporté dans ces formes prolongées.
Les cas sévères ou mortels de chikungunya sont rares, et sont généralement associés à l’existence d’autres pathologies (facteurs de risque : âge de plus de 65 ans, comorbidités, arthralgies préexistantes).
Le chikungunya peut affecter les personnes de tous âges. L’incidence de la maladie symptomatique et sa sévérité, ainsi que le taux de mortalité augmentent avec l’âge. Plus de la moitié des cas graves concernaient des patients âgés de 65 ans.
Les formes graves touchent préférentiellement les personnes à des âges extrêmes : nouveau-nés par transmission materno-fœtale et/ou per-partum et sujets âgés de 65 ans et plus. Les comorbidités telles que l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les maladies neurovasculaires sont des facteurs de risque de sévérité et/ou de surmortalité liés à la maladie.
Diagnostic
Le diagnostic de l’infection par le virus chikungunya est réalisé par des techniques qui peuvent être directes (détection du virus par culture ou de son génome par PCR) ou indirectes (détection d’anticorps par sérologie).
La démarche diagnostique, recommandée dans le plan ministériel « Anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole », est la suivante :
- Jusqu’à 5 jours après le début des signes (J5) : RT-PCR
- Entre J5 et J7 : RT-PCR et sérologie
- Après J7 : sérologie uniquement (IgG et IgM) avec un second prélèvement de confirmation au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement
Ainsi, il est primordial d’identifier avec précision la date de début des signes (DDS) afin de choisir les analyses à réaliser.
Les tests précoces (jusqu’à J7) par RT-PCR doivent être privilégiés du fait de leur spécificité supérieure à la sérologie. Les IgM peuvent être identifiées à partir du cinquième jour après l’apparition des signes cliniques et persistent en moyenne 2 à 3 mois. Les IgG apparaissent quelques jours après les IgM et persistent toute la vie.
Des IgM isolées doivent impérativement conduire à un 2nd prélèvement pour confirmation, au minimum 10 jours après le premier. Le diagnostic de chikungunya sera confirmé en cas d’apparition d’IgG dans le second échantillon, ou devant un titre croissant d’IgG (en principe, au moins 4 fois plus élevé que sur le premier prélèvement sanguin).
À La Réunion, chez les patients suspectés d’être infectés (signes cliniques tels que fièvre ≥ 38,5°C associée ou non à des céphalées, des douleurs musculaires et/ou articulaires, des nausées/vomissements et un rash cutané en l’absence de tout autre point d’appel infectieux), la RT-PCR doit être effectuée le plus rapidement possible après l’apparition des symptômes. Dans le cas où une RT-PCR n’est pas pertinente (> J7) et qu’une sérologie est réalisée, celle-ci doit nécessairement être répétée à J14 de la date de début des symptômes.
Prévention
Au niveau local, la prévention repose essentiellement sur l’élimination des déchets et eaux stagnantes ou la prévention des piqûres de moustiques (vêtements longs, répulsifs, moustiquaires). Des mesures de de démoustication autour de l’ensemble des cas peuvent être déployées par le service de lutte antivectorielle de l’ARS.