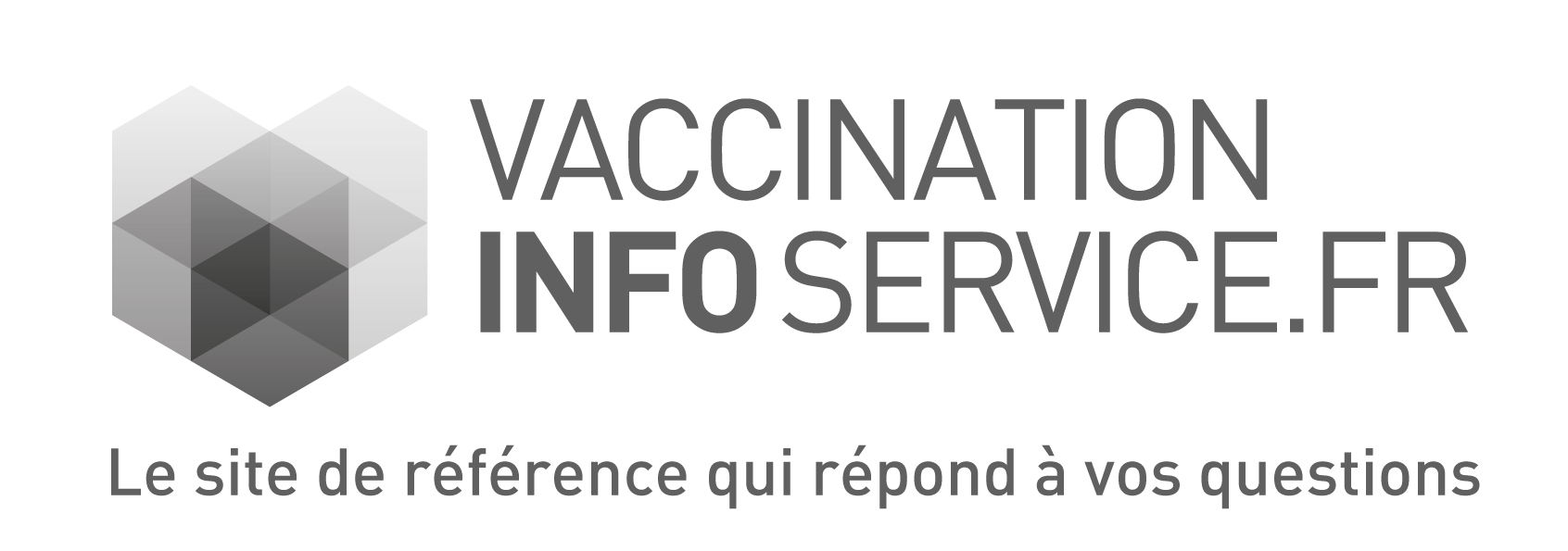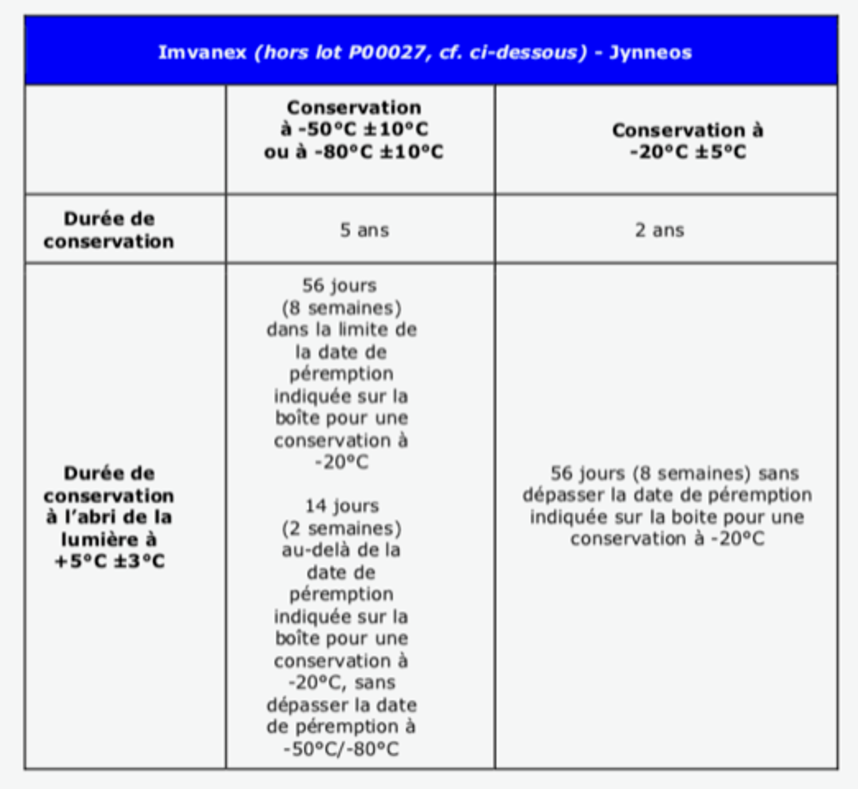Clinique
Après une période d’incubation pouvant aller de 5 à 21 jours, l’infection débute en général par de la fièvre, des céphalées, des myalgies et une asthénie. Des adénopathies sous-maxillaires, cervicales et/ou inguinales volumineuses sont retrouvées pour la Mpox (contrairement à la variole).
La personne est contagieuse dès l’apparition des premiers symptômes.
Dans les 1 à 3 jours (parfois plus) suivant l’apparition de la fièvre, le patient développe une éruption cutanée sous forme de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement, la formation de croutes puis la cicatrisation. Le nombre de vésicules ou lésions peut être très variable. L’atteinte cutanée survient en une seule poussée, contrairement à la varicelle. Le prurit et les douleurs sont fréquentes. Les bulles se concentrent sur la région ano-génitale mais aussi sur le visage, les paumes des mains, les plantes des pieds et les membres. Les muqueuses buccales et ano-génitales peuvent aussi être atteintes.
Lorsque les lésions sont cicatrisées et que les croûtes tombent, les personnes ne sont plus contagieuses.
La maladie guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 4 semaines. Quelques décès ont été signalés en Europe et dans le Monde.
Le 21 octobre 2022, l'EMA a également rapporté certains cas de "Mpox oculaires", des patients atteints de Mpox et présentant de graves complications oculaires.
Le CDC a publié le 26 octobre 2022 une étude sur les manifestations sévères de la Mpox, observées chez les personnes immunodéprimées. Entre août et octobre 2022, le CDC a analysé le cas de 57 patients hospitalisés présentant des manifestations graves de Mpox, dont la plupart étaient des hommes noirs atteints du SIDA. Des retards ont été observés dans l'initiation des thérapies dirigées contre le Mpox. Douze patients sont décédés, et le Mpox était une cause de décès ou un facteur contributif chez cinq patients à ce jour, et plusieurs autres décès font encore l'objet d'une enquête.
En France, la majorité des cas recensés à ce jour sont des adultes de sexe masculin. Une description clinique des cas investigués en France est disponible dans les points de situation de Santé publique France.
Des infections par Mpox peuvent survenir chez des personnes ayant reçu un schéma complet de vaccination, et il est important de penser à ce diagnostic en cas de lésions typiques y compris chez des personnes correctement vaccinées.
Tout cas suspect doit bénéficier d'une consultation médicale et d'un test diagnostique (PCR). Le prélèvement est réalisé par ordre de priorité au niveau d’une lésion muqueuse, cutanée ou de la sphère oro-pharyngée. Le test est gratuit. Il peut être réalisé en ville sur prescription médicale. La conduite à tenir est présentée dans le DGS-Urgent du 4 mai 2023.
Un traitement par Tecovirimat®, qui a reçu une AMM européenne, est disponible en France dans les centres spécialisés pour les cas graves hospitalisés.
La déclaration de la maladie est obligatoire. Un nouveau modèle du certificat de déclaration a été fixé par un arrêté du 25 août 2022. Il est disponible sur le site de Santé Publique France, avec la définition de cas, la nouvelle conduite à tenir et la notice d’aide au remplissage de la fiche de déclaration.
L’ensemble de la conduite à tenir a été formalisée par le ministère de la santé dans une fiche disponible sur le site du ministère.
Epidémiologie
En France, les orthopoxviroses dont font partie la Mpox font l’objet d’une surveillance continue par ce dispositif de déclaration obligatoire.
Depuis mi-mai 2022, plusieurs foyers de contamination de Mpox ont été détectés d’abord au Royaume-Uni, puis dans d’autres pays d’Europe dont en France, puis très rapidement sur d’autres continents.
Des points de situation sont régulièrement mis à jour et disponibles sur le site de Santé publique France .
En complément de la DO, il est recommandé d'inciter les patients concernés à répondre à l’enquête comportementale anonyme « MECCDO » (https://meccdo.fr) qui permet de mieux comprendre les comportements et pratiques sexuelles des personnes contaminées afin d’adapter les stratégies de prévention.
Actuellement, en France, plus de 95 % des cas pour lesquels l'orientation sexuelle est renseignée sont survenus chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH). Parmi les cas pour lesquels l'information est disponible, 71 % déclarent avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans les 3 semaines avant l'apparition des symptômes.
Le CDC a publié le 11 novembre 2022 les résultats d'une étude épidémiologique menée aux Etats-Unis, relayant que 70% des personnes contaminées par le Mpox concernaient des relations HSH, et que les contaminations différaient en fonction des origines ethniques.